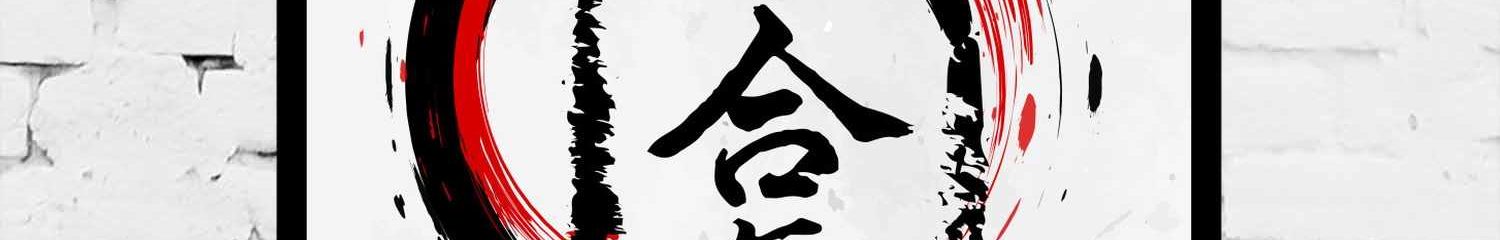Je pratique l’aikido depuis maintenant cinq ans. En cinq ans, je suis passée par différentes phases, en commençant par le doute, la peur, la résignation, mais également la persévérance et le plaisir. C’est pourtant après les périodes difficiles de stagnation et d’appréhensions que sont apparus les premiers signes de progression. J’ai donc identifié les moments incontournables d’inconfort et d’adaptation par lesquels passent les aikidokas, conditions sine qua non de la progression.
.
Pratiquant : sortir de son club, pour sortir de sa zone de confort

Il y a un an, j’ai décidé de quitter Paris pour découvrir la France, l’Europe, puis le monde. Au cours de ce voyage personnel (et professionnel), j’ai décidé de pratiquer l’aikido dans les différents qui m’ont ouvert leurs portes.
Et c’est dans ce contexte que j’ai réaliser qu’un bon aikidoka doit savoir s’adapter à tout type de situation dans un nouveau dojo : au niveau des techniques dont les formes peuvent changer en fonction des écoles, à la pédagogique qui change en fonction des enseignants, et enfin à la philosophie de l’aikido propre à chaque courant.
A l’occasion du stage de Marc Bachraty à Ivry-la-Bataille, nous faisions le constat que beaucoup d’élèves ne sortent que rarement de leur dojo. Et par conséquent, ne confrontent pas leur pratique à d’autres aikidokas de divers horizons.
Or découvrir de nouvelles façons d’enseigner nous permet de réaliser une chose essentielle en aikido : ne jamais s’asseoir sur ses lauriers car le travail n’est jamais fini.
La recherche est permanente, et la découverte de nouveaux enseignants, de nouvelles pratiques et de nouveaux pratiquants nous apprend l’adaptabilité et la dextérité.
Cette adaptabilité sert certes à la préparation des passages de grade, mais surtout à tester l’efficacité de notre aikido en zone inconnue.
C’est dans ce contexte que l’adaptabilité, qualité essentielle de l’aikido, ressort, et nous permet de travailler main dans la main avec notre partenaire, sans qui, notre pratique n’aurait plus de sens. Pratique sans écoute n’est que ruine de l’âme. Après tout, cette complicité n’est-elle pas au coeur de la recherche de l’harmonie dont on parle tant dans notre chère discipline ?
.
Pratiquant : changer plusieurs fois de club en tant que débutant peut se révéler positif

.
L’idée me semble compréhensible. Mais dans les faits, les circonstances m’ont empêchée de m’y tenir :
.
J’ai changé de club après l’obtention de mon deuxième Kyu en 2020, et depuis, beaucoup de chamboulements se sont produits : un enseignement en dent de scie dans plusieurs clubs parisiens (au rythme de la crise sanitaire), la pratique en extérieur, la découverte des clubs de province et à l’étranger, mais également la participation à de plus en plus de stages…Me voilà dans aujourd’hui de retour à Paris dans un nouveau club !
.
Je n’avais pas de bases très solides lorsque j’ai vécu ces différentes expériences sur les tatamis.
C’est seulement aujourd’hui, avec (un peu) plus d’expérience que je commence à faire des connexions entre les différents enseignements que j’ai reçus ; le travail d’assimilation commence :
.
Maintenant que mes bases sont un peu plus consolidées, j’arrive à progresser plus vite, en réutilisant les enseignements vus lors de mes débuts sur les tatamis, un peu comme si j’avais appris les choses dans un ordre inversé. C’est pourquoi, d’un point de vue pédagogique, il est toujours mieux recevoir le bon conseil au bon moment.
.
Prenons un exemple : j’ai commencé par apprendre des formes “complexes” de techniques de bases à mes débuts (sans connaître les kihon waza) mais qui m’étaient encore difficilement réalisables à l’époque. Aujourd’hui, je peux plus facilement intégrer ces variantes à mon éventail de techniques.
.
De la même manière, ma participation régulière à des stages me permet de m’habituer à des enseignements différents, et d’avoir une vision plus globale de la réalisation des techniques. Les stages participent à la reconnexion des pièces du puzzle.
.
Enfin, j’arrive maintenant à intégrer la notion de plaisir sur les tatamis, lors de ju waza, en chutant, mais également en pratiquant les armes, grâce à un nouvel enseignement “ludique” qui me correspond.
.
Cet apprentissage inversé n’est sûrement pas celui qu’on préconiserait à un débutant, mais il me fait toutefois prendre conscience que je n’ai pas perdu mon temps, ni en changeant de club, ni en mettant ma pratique en pause pendant les confinements.
Chaque apprentissage rencontre des paliers de stagnation, mais ces périodes de retropédalage précèdent des avancées plus significatives en terme de pratique.
Voici donc un retour d’expérience d’une débutante, qui a su tirer profit d’un parcours chaotique, du moins sur le papier 😉
Retour d’expérience : aikido à l’étranger ou la force de l’adaptation

Pratiquer l’aikido hors de son dojo, c’est une nouvelle façon de s’adapter.
Il y a quelques mois, j’ai pratiqué dans des dojos que je ne connaissais pas, et qui ont eu la gentille de m’accueillir : d’abord en France, en province, puis à l’étranger, au Portugal, et maintenant en Amérique latine, au Costa Rica puis au Mexique.
Quand on est débutant, c’est à la fois une richesse mais aussi une perte de repères. Nos bases ne sont pas encore consolidées qu’on observe déjà des changements de pratique, et d’enseignement. Un véritable déboussolement.
Que prendre et que laisser ?
Chaque dojo a son école, sa philosophie et cela se retranscrit dans la pratique.
Au Mexique, la philosophie est moins tournée vers la martialité que vers une dimension plus spirituelle, centrée vers les sensations interne.
Ce qui explique que le cours commence par une méditation.
Alors comment construire ses bases quand on est en perte de repère ?
Je pense qu’il faut tout simplement lâcher-prise, garder en tête nos premiers enseignements et s’enrichir des suivants. C’est notre corps et nos sensations qui feront la synthèse de ce tout harmonieux.
Evidemment, il n’y a plus qu’à 😉
Enseignement : adopter une pédagogie adaptable à tout niveau

Il y a quelques jours, j’échangeais avec mon ami Pierre Fissier, du blog Aiki-kohai, sur la pédagogie en aïkido, un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
Nous avons tous les deux fait le constat que certains clubs rassemblaient des publics homogènes essentiellement composés de gradés.
Dans ces clubs, le débutant doit trouver sa place pour se hisser au niveau de la majorité.
Evidemment, personne ne demande à un 4e kyu de se hisser au niveau d’un 3e dan, mais prendre le train en marche est chose difficile quand on débute.
Dans ce cadre, proposer une pédagogie adaptative me semble être une idée pertinente. Mais ma vision de la pédagogie ne fait pas l’unanimité auprès d’enseignants qui veulent niveler le niveau de leur club par le haut, sans pour autant aider les élèves les plus novices à franchir les marches vers les paliers supérieurs.
Derrière cet aveuglement, de l’inconfort : l’inconfort de devoir changer sa manière d’enseigner, l’inconfort de devoir répondre à des questions perturbantes, l’inconfort de pratiquer avec des élèves qui ne chutent pas comme on veut, l’inconfort de pratiquer avec des gabarits atypiques, l’inconfort de devoir expliquer et décomposer, l’inconfort d’avouer son ignorance.
Car oui, c’est facile de parler de pédagogie efficace, ou d’éminent sensei quand ce dernier enseigne à un public de gradés.
Un sensei n’est pas seulement grand de par son grade, mais de par sa capacité à transmettre à ses élèves une vision, une pratique, mais aussi de les accompagner sur le chemin de cette voie qui leur est proposée.
Pour être un échantillon représentatif de la diversité des aikidokas, un club doit pouvoir drainer un public hétérogène, mais surtout proposer une pédagogie adaptable à tout niveau.
Enseignement : porter un regard de débutant sur l’aikido régulièrement