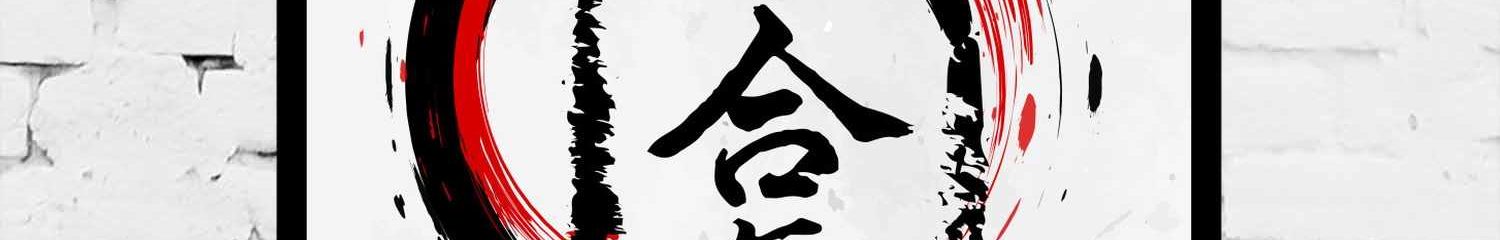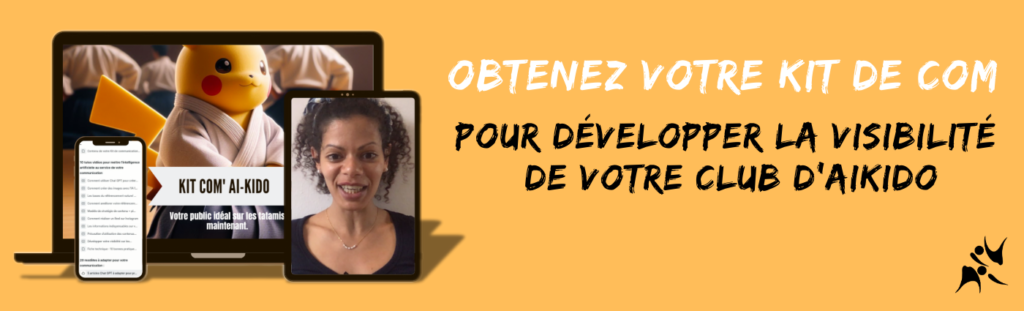En Aïkido, on parle souvent de progression individuelle : fluidifier son mouvement, améliorer sa posture, ou encore, développer son intelligence corporelle. Pourtant, cette progression ne se fait pas dans le vide. Elle prend appui sur un cadre, un club, un enseignant, des partenaires de pratique, des habitudes… et parfois des croyances ou des injonctions qui ne sont jamais remises en question.
Pourtant, si l’on souhaite faire évoluer sa pratique, peut-être faut-il commencer par observer l’environnement dans lequel elle s’inscrit. Quelle est la pédagogie transmise dans mon club ? Quelle place donne-t-on à l’information ? Les critères d’évaluation sont-ils clairs ? Le rôle de chacun est-il explicité ? Et surtout : est-ce que les règles sont connues, cohérentes, et partagées par tous ?
Voici trois réflexions tirées de mon expérience de pratiquante et d’enseignante, pour interroger ces repères et ce que l’on considère parfois – un peu trop vite – comme des vérités immuables.
Pédagogie : ces phrases toutes faites que l’on ne questionne pas en Aïkido

L’enseignement de l’Aïkido connaît un écueil pédagogique : la répétition de phrases toutes faites dénuées d’explications.
Parmi elles :
– Le fameux “relâche”, sans conseil “activable” pour prendre conscience que l’on est tendu.
-“C’est pas les bras, c’est les hanches”, sans prendre en considération que lorsqu’on est débutant, nos yeux voient des bras s’agiter et que lorsqu’on n’arrive pas encore à mobiliser ses hanches, les bras viennent réaliser une partie du mouvement.
– “Pour être un bon tori, un faut être un bon Uke”, alors que les deux rôles sont distincts (et on le voit dans l’organisation des passages de grade où Tori est évalué à 90%), même si je pense qu’il faut être Uke pour ressentir les deux versants de l’Aïkido.
– “Il ne faut pas faire la course aux grades”, de la part d’enseignants qui ont passé leur 4e dan ou plus. Gardons en tête que chacun a ses raisons personnelles de passer des grades, que ce soit pour progresser, enseigner ou pour renforcer sa confiance en soi. Soit un élève est prêt, soit il ne l’est pas, mais le jugement de valeur n’a pas sa place dans l’enseignement.
– “Suburi : quand tu auras tellement mal aux épaules, tu finiras par te relâcher”. Sûrement pas la meilleure manière de rendre la pratique des armes attractive, ni d’encourager la détente du corps, qui se met en état d’alerte.
– “La meilleure manière de comprendre, c’est de ressentir” : pas pour tout le monde, car cela dépend de sa mémoire de prédilection (kinesthésique, visuelle ou auditive). Ce n’est pas parce qu’on reçoit 10 fois la technique que l’on saura l’exécuter. Parfois, des mots simples facilitent la compréhension, et par conséquent, l’exécution.
Pour conclure, je dirais que ces conseils, aussi bien intentionnés soient-ils, n’aident pas le pratiquant à progresser. C’est pourquoi, il est important, en tant qu’enseignant, de rester à l’écoute de ses élèves, de continuer à pratiquer régulièrement, de se former et garder un état d’esprit de débutant : le Shoshin C’est le Shoshin qui permet en effet de rester humble mais également de puiser dans ses souvenirs lointains et réveiller le débutant qui sommeille dans chaque pratiquant.
Passages de kyus : et si on harmonisait les critères d’évaluation en club

Dans la fédération dans laquelle je pratique l’Aïkido, des critères d’évaluation clairs sont énoncés pour les passages de grade dan (ceinture noire).
Mais avant le passage de ceinture noire, il n’y a pas d’harmonisation des critères d’évaluation pour les passages de kyus en club (du moins, pas à ma connaissance). Et de ce que j’ai pu observer en quasi 8 ans de pratique, chaque club fait à sa sauce.
Il en est de même pour la remise du Hakama où, au sein même d’une fédération, les règles changent en fonction des clubs (remise du Hakama au 3e kyu, 2e kyu ou 1er kyu, et je ne parle même pas des clubs qui ne font pas passer les kyus).
En découle une question : est-ce qu’on reçoit son hakama lorsqu’on est un bon Tori ou lorsqu’on est un bon Uke ?
De même, rien n’a été arrêté sur la couleur des ceintures des pratiquants kyus adultes : avant la ceinture noire, tous les kyus adultes doivent-ils porter des ceintures de couleur blanches ?
Ou bien, peut-on envisager un système de couleur comme il existe dans d’autres disciplines martiales (Judo, JJB, Kung Fu) ou chez les enfants ?
En Aïkido, certains clubs utilisent le système des ceintures de couleur même pour les adultes, mais ce n’est pas la majorité.
La question de la couleur des ceintures m’interroge également sur l’organisation des passages de grade enfants : ici encore, chaque club fait les choses à sa sauce.
En résumé, les critères d’évaluation sont clairement énoncés en ce qui concerne les passages de ceinture noire (il y a même des formations à l’évaluation pour les enseignants), mais avant cela, un flou demeure.
Il pourrait être intéressant d’harmoniser l’organisation des passages de kyus, mais également des ceintures enfants pour que l’on puisse s’entendre sur le niveau requis pour porter un Hakama ou pour juger de ce qu’est un « bon Aikidoka ».
Club professionnel versus club de loisir : un faux débat

Récemment, j’ai entendu à plusieurs reprises qu’on opposait des clubs dits “professionnels” à des clubs dits “de loisir”.
Je comprends la distinction qui peut être faite.
L’un serait plus focalisé sur la préparation aux grades alors que l’autre serait plus porté sur le plaisir de la pratique.
Pour moi, il ne devrait pas y avoir de distinction, car un club devrait pouvoir faire les deux, même si les adhérents ont des aspirations différentes.
Ce qui compte, c’est que le « contrat » tacite entre l’enseignant et l’élève soit clair. Un élève qui décide de pratiquer une fois par semaine pour le plaisir est libre de le faire. Un élève qui souhaite passer un grade doit en parler avec son enseignant pour voir quel accord ils peuvent trouver quant à cet objectif.
Aujourd’hui, nous avons de la documentation qui nous permet de savoir quels sont les délais pour passer des grades, et quelle est la fréquence de pratique nécessaire par rapport à ces délais.
Le devoir de l’enseignant et du club est d’informer les élèves sur l’existence des passages de grade (kyu et dan), des diplômes d’enseignants (BF, CQP), des formations proposées par la Fédération ou les ligues, et les conditions pour y accéder.
Bien sûr, un enseignant peut dissuader un élève, si le niveau n’est pas à la hauteur des exigences demandées. Inversement, un élève n’est pas obligé de suivre les ambitions de son enseignant pour lui.
Mais le plus important reste le devoir d’information pour que chacun puisse choisir en pleine connaissance de cause.
Pour ma part, j’ai eu la chance d’être bien accompagnée tout au long de ma pratique et d’avoir pu bénéficier d’un suivi régulier.
Mais je sais que ce n’est pas le cas de tout le monde.
Pour revenir au sujet des clubs professionnels versus clubs de loisirs, je conclurai en disant que le débat n’est pas celui de l’opposition, mais celui du devoir d’information des clubs auprès de leurs adhérents.
À méditer.
Conclusion
Ce qui ressort de ces réflexions, c’est qu’un club n’est pas simplement un lieu d’apprentissage technique. C’est un cadre, un espace de transmission, de construction, de dialogue, où les pratiques pédagogiques, les règles implicites et explicites, les attentes et les trajectoires doivent pouvoir être partagées et discutées.
Interroger ce cadre, c’est aussi une manière de progresser. Pour l’enseignant comme pour l’élève.
Car en Aïkido, progresser, ce n’est pas seulement apprendre des techniques. C’est aussi apprendre à se situer, à choisir, à comprendre ce que l’on transmet… et ce que l’on reçoit.