On entend souvent qu’en Aïkido, le corps apprend par la répétition et que le ressenti prime. Et ce n’est pas faut ! Mais à certains moments de notre parcours, une autre voie se dessine : celle de la pensée.
Penser sa pratique ne signifie pas la figer ni l’intellectualiser à outrance. Cela veut simplement dire qu’au-delà du geste, au-delà du ressenti, il y a une compréhension à construire, une réflexion à nourrir, un regard à affiner. Qu’on le veuille ou non, pratiquer l’Aïkido, c’est aussi s’interroger : sur ce que l’on fait, sur comment on l’apprend, et sur les raisons pour lesquelles on persévère.
Les trois idées suivantes sont différentes facettes de la réflexion dans notre pratique.
1/ Aïkido : pourquoi est-il important de mener notre propre réflexion sur la pratique ?

Une amie qui révisait le Brevet Fédéral cette année m’a demandé ce que je pensais du sujet consacré au principe d’irimi, et notamment comment l’illustrer au mieux.
Sans refaire toute la conversation, ce que je trouve intéressant avec le principe d’irimi en Aïkido, c’est que pour moi, tout peut être irimi.
On m’avait dit une fois qu’en Aïkido, on ne reculait jamais. À partir de ce moment-là, j’ai compris que toute technique pouvait incarner ce principe. Bien sûr, certaines s’y prêtent plus facilement que d’autres pour l’illustrer, mais dans le fond, la pratique dans son ensemble peut être une expression d’irimi.
Et c’est là que, pour moi, commence le vrai sujet. Parce que ce que je trouve intéressant dans le BF ou dans d’autres formations, c’est qu’on y apprend à penser la pratique.
Car la pratique, ce n’est pas juste une question de ressenti.
C’est aussi une manière de comprendre la philosophie et les principes qui fondent notre discipline.
Le ressenti, ça ne suffit pas. Pédagogiquement, ça ne parle pas à tout le monde. Et ça n’explique pas tout.
C’est un peu comme regarder un film dans une langue qu’on ne parle pas, sans les sous-titres. On perçoit les émotions, on comprend un peu l’intention. Mais on passe à côté de l’histoire.
Ressentir, répéter, faire taire son mental : oui.
Mais réfléchir, échanger, vouloir comprendre : c’est un grand oui aussi.
N’oublions pas que nous pratiquons un budo, avec une philosophie, des valeurs et des principes.
Et le budo, c’est aussi une invitation à nourrir une réflexion personnelle et collective.
Ne nous en privons pas.
2/ Aïkido et parcours universitaire : de discipline et même regard sur l’apprentissage

Cette invitation à penser ce que l’on pratique ne concerne pas que les techniques. Elle s’applique aussi à notre manière de progresser, d’apprendre, et d’envisager notre parcours. Car il existe autant de trajectoires que de pratiquants.
Quand j’étais à la fac, on me disait que ce n’était pas terrible pour mon CV de faire ma L3 de science politique à l’étranger.
Parce que ça ne montrait pas un parcours linéaire.
Et parce qu’aux États-Unis, les notes étaient plus élevées qu’en France (ce qui n’est pas très compliqué).
C’est vrai.
Ma licence de science politique ne ressemble pas à un parcours classique.
Une première année de prépa hypokhâgne, une équivalence en deuxième année de fac, puis une troisième année à l’université de Californie (UC Irivine).
.
Je n’ai pas approfondi la science politique comme quelqu’un qui serait resté dans le même cadre pendant 3 années consécutives.
Mais je me suis nourrie d’environnements variés. Et c’est ce qui rend mon parcours riche.
Pour l’Aïkido, on m’a dit la même chose.
Que c’était mieux de rester avec un enseignant pendant des années, pour poser des bases solides.
Pour ne pas s’égarer.
Et je pense que le conseil est justifié !
Toutefois, une question revient : à partir de quand considère-t-on qu’on a des bases solides ?
Je ne suis jamais restée plus de trois ans avec un enseignant.
Mais j’ai vu beaucoup de choses, à savoir, des approches différentes et des cultures différentes.
Ce qui m’a permis de développer une vraie capacité d’adaptation.
Aujourd’hui, je ne sais pas si mes bases sont considérées comme solides mais je sais que mon parcours est riche.
Ce n’est pas parce que vous sortez des sentiers battus et que vous ne suivez pas la voie jugée comme sérieuse par le plus grand nombre, que votre parcours à moins de valeur.
3/ L’Aikido, c’est compliqué, mais c’est ce qui nous fait persévérer

Et finalement, si réfléchir est essentiel, et si chaque parcours est unique, il faut aussi reconnaître une chose : l’Aïkido est difficile. Et c’est précisément cette complexité qui nous forge.
L’Aikido c’est compliqué car ce n’est pas intuitif !
👉 On vous demande d’attaquer avec conviction mais de ne pas bloquer le partenaire
👉 On vous demande d’être mobile, mais de ne pas chuter tout seul
👉 On vous demande d’être relâché tout en étant présent et attaquant
👉 On vous demande d’attaquer “franchement” tout en jouant le jeu de la connexion à l’autre et en acceptant la codification des déplacements
👉 On ne peut réaliser certaines techniques que si Uke se place « correctement ». Et entre pratiquants de différentes écoles, on ne se positionne pas toujours de la même manière.
👉 Les techniques ne sont pas toujours facile à réaliser en fonction de notre gabarit (trop grand, trop lourd, trop petit…)
Si je devais “vendre” l’Aikido à un néophyte, je n’axerais pas mon argumentaire sur la simplicité de la pratique, mais au contraire sur la complexité qui rend la discipline riche, tout comme sur le fait que l’on pourra peut-être mettre une vie à en faire le tour.
Si cet argument ne le séduisait pas, je lui dirais également que l’on peut rapidement gagner en confiance en soi, qu’en travaillant régulièrement, on peut devenir ceinture noire sans attendre d’avoir des cheveux blancs, que l’absence de compétition n’est pas synonyme d’absence de challenge, et que l’Aikido permet encore de faire des choses surprenantes avec son corps, même en étant raide, même en étant lourd, même en étant petit, même en étant vieux, et même sans force.
Conclusion
Pratiquer l’Aïkido, ce n’est pas seulement répéter des techniques. C’est apprendre à penser, à s’adapter, à persévérer.
C’est accepter que le chemin ne soit pas toujours droit, ni facile — mais qu’il soit profondément formateur.
Penser sa pratique, embrasser la diversité des expériences et accueillir la complexité : voilà peut-être trois clés pour avancer, profondément, sincèrement… et durablement.
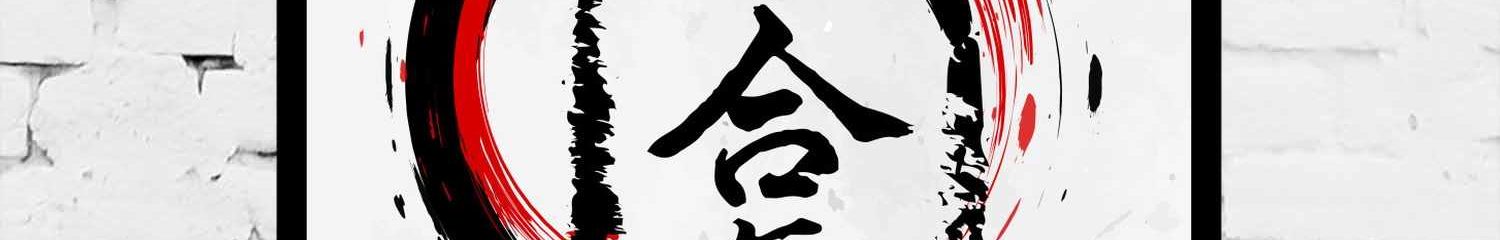
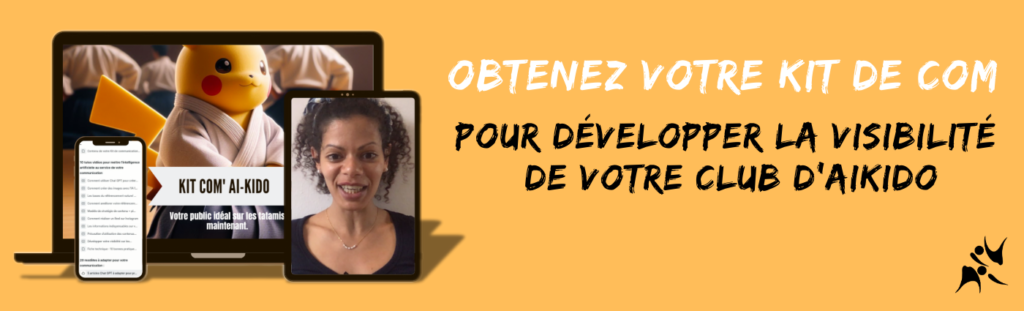
Comme à l’accoutumée, ton article est une fois de plus “inspirant”.
Merci
Patrick