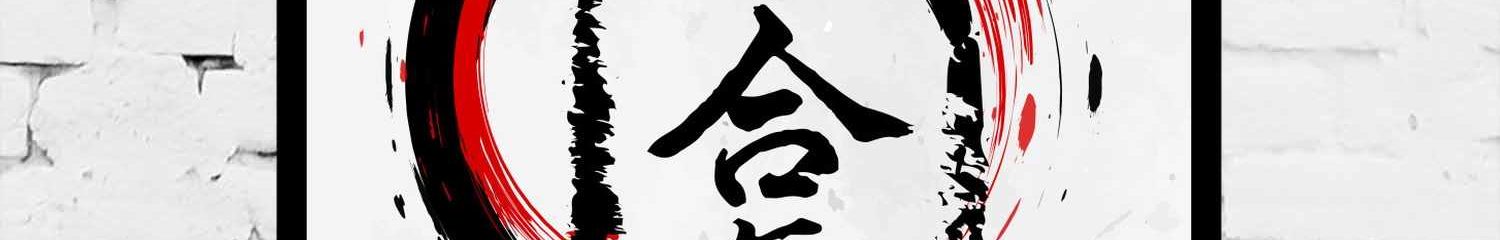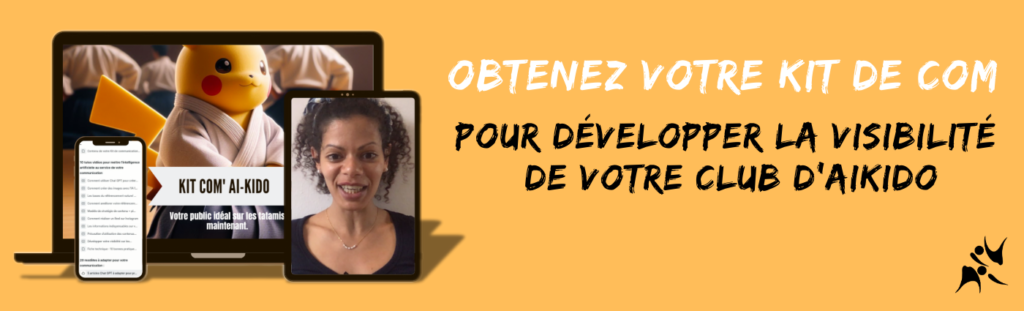En 2025, 327 signalements ont déjà été enregistrés sur les cinq premiers mois, soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année dernière sur la même période. Cette progression révèle une double réalité : la persistance de comportements inacceptables, mais aussi une parole qui se libère peu à peu.
On parle régulièrement des violences faites aux femmes dans le sport. Pourtant, avant même d’entrer dans le détail, il faudrait d’abord clarifier ce que l’on met derrière le mot violence.
Pour beaucoup, seules les agressions physiques évidentes comptent. Pourtant, la violence verbale, les gestes intrusifs, les propos humiliants, les avances insistantes ou encore les blagues sexistes répétées relèvent aussi de la violence. Ne pas le reconnaître, c’est participer à ce que l’on appelle la “rape culture” : une culture qui banalise, excuse ou minimise les violences sexuelles et sexistes dans le sport, et particulièrement les arts martiaux.
Dans les arts martiaux, et notamment en Aïkido, cette contradiction est particulièrement visible : on parle de respect, d’harmonie, de maîtrise de soi, mais certains comportements tolérés en dojo disent l’inverse.
Une violence banalisée dans la pratique des arts martiaux
Cette minimisation se retrouve régulièrement dans les dojos. On dit à une pratiquante qu’un geste déplacé « n’était pas méchant », mais « normal parce qu’il est tactile ». On conseille à une élève de « ne pas trop réagir » face à des propos sexistes pour éviter de « faire des histoires ». Et quand une femme dénonce, on l’accuse parfois d’être « parano » ou de chercher des problèmes là où il n’y en a pas.
Ces exemples ne sont pas anecdotiques : ils traduisent un mécanisme courant qui déplace la responsabilité sur la victime plutôt que sur l’auteur. Le problème n’est plus le comportement déplacé, mais la réaction de celle qui le subit. Ce qui devrait être jugé inacceptable est ainsi toléré, voire justifié.
L’injonction irréaliste à réagir immédiatement
À cela s’ajoute une pression supplémentaire : on attend souvent des victimes qu’elles réagissent immédiatement. On leur dit qu’il faut « repousser fermement », « dénoncer sur le moment ».
Mais cette attente ne correspond pas à la réalité. Lorsqu’un geste ou une parole déplacée survient, il est fréquent d’être décontenancée, sidérée, incapable de réagir dans l’instant. Le silence qui suit n’est pas une approbation. C’est une réaction humaine face à l’inattendu et à la violence.
Exiger une réponse instantanée, c’est méconnaître le mécanisme de sidération. C’est encore une fois déplacer la responsabilité sur celles qui subissent, plutôt que sur ceux qui dépassent les limites.
Pourquoi les arts martiaux exigent une vigilance particulière
Ces mécanismes existent dans de nombreux sports, mais ils prennent une ampleur particulière dans les arts martiaux. Trois éléments principaux s’y conjuguent.
D’abord, une culture traditionnelle hiérarchisée, où la parole de l’élève pèse moins que celle du professeur ou du gradé. Ensuite, le contact physique permanent, constitutif de la pratique, qui rend la frontière entre cadre et intrusion plus fragile et parfois floue. Enfin, une culture de la martialité et de l’endurance, qui valorise la capacité à supporter sans se plaindre, qui touche aussi les femmes, jusqu’à faire croire que la force réside dans le silence.
En Aïkido comme dans d’autres disciplines martiales, cela peut conduire à normaliser ce qui ne doit jamais l’être, sous prétexte de hiérarchie, de tradition ou de culture de l’effort.
Le silence n’est pas un signe de résilience
Certaines femmes ont intégré l’idée que, pour être acceptées et « se faire une place » dans ce milieu, il fallait se taire, encaisser remarques et gestes sans broncher. Mais cela n’a rien à voir avec la force. Ce n’est pas une question de courage ou de résistance. C’est une question de respect — respect que chacun doit recevoir, sans condition.
Car la force, ce n’est pas de se taire et d’encaisser. La véritable force, c’est de refuser et de dénoncer.
Et le problème, ce n’est pas de tester ce que l’on est capable d’endurer, mais jusqu’où l’on autorise.
La tradition martiale ne justifie pas les dérives
Il est essentiel de rappeler que la tradition des arts martiaux ne valide pas ces comportements. Au contraire. Les règles du dojo, l’étiquette, la hiérarchie et les valeurs de la discipline ont pour but d’enseigner le respect et la sécurité mutuelle.
Dans le code moral du judo, le respect est une valeur fondamentale. En Aïkido, l’étiquette du dojo, le reishiki, rappelle que l’autre est un partenaire indispensable, et que sans ce partenaire, il n’y a pas de pratique possible. Utiliser la hiérarchie ou la tradition pour réduire une victime au silence, c’est détourner et dévoyer les valeurs d’harmonie et de respect qui font partie de l’Aikido.
Le cas de l’Aikido : préserver l’harmonie, c’est savoir dire non à ce qui la brise

L’harmonie, dans un dojo, ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas, dans la confiance, le respect et la sécurité.
Pourtant, il arrive que cette harmonie soit mise à mal : par des comportements violents, humiliants, ou tout simplement irrespectueux de l’esprit de l’Aïkido.
Face à cela, nous avons souvent un réflexe : se taire, pour “ne pas faire de vagues”.
Par peur de diviser le groupe, de remettre en cause l’autorité d’un enseignant, ou de fragiliser la cohésion du club.
Mais c’est une illusion.
👉 Ce qui fragilise réellement un dojo, ce n’est pas la parole qui alerte. C’est le silence qui couvre.
👉 Ce qui met en danger la cohésion, ce n’est pas celui qui dit non. C’est celui qui impose la peur ou l’abus.
Dire non, c’est protéger
Savoir dire non à ce qui brise l’harmonie, ce n’est pas de la délation :
– C’est préserver la confiance mutuelle.
– C’est garantir la sécurité psychologique et physique de chacun.
– C’est donner à la cohésion une base solide, fondée sur le respect.
Un dojo où l’on ose parler et agir face à ce qui menace l’équilibre est un dojo plus fort, plus soudé.
Car la cohésion réelle ne se bâtit pas sur l’omerta, mais sur la clarté et la protection de tous.
Des outils existent
Aujourd’hui, les pratiquants ne sont pas seuls :
👉 La cellule d’écoute de la FFAAA peut recueillir des témoignages et accompagner les victimes ou témoins : celluledecoute@aikido.com.fr
👉 La plateforme nationale Signal-Sports (ministère des Sports) s’engage à donner une réponse sous 72 heures à toute personne signalant une situation de violence sexiste, sexuelle ou discriminatoire : signal-sports@sports.gouv.fr
Préserver l’esprit de l’Aïkido
Refuser de fermer les yeux n’est pas salir notre discipline.
C’est au contraire rester fidèle à son esprit :
– protéger,
– respecter,
– et créer un espace où chacun peut progresser en confiance.
Préserver l’harmonie, c’est parfois savoir dire non. Et ce “non” est une façon de dire “oui” à l’Aïkido.
Conclusion : rester fidèle aux valeurs des arts martiaux
Un dojo doit être un espace d’apprentissage, de respect et de sécurité. Tant que la “rape culture” et la minimisation des violences trouveront refuge derrière la hiérarchie, la tradition ou la culture de l’endurance, les arts martiaux seront trahis dans ce qu’ils ont de plus précieux : leurs valeurs.
La vigilance est une responsabilité collective. Elle concerne aussi bien les enseignants que les élèves, les gradés comme les débutants. Reconnaître ces mécanismes et s’y opposer, c’est protéger la dignité des pratiquants, mais aussi préserver l’essence même des arts martiaux. Car un art qui revendique respect et harmonie ne peut pas fermer les yeux sur ce qui les détruit.