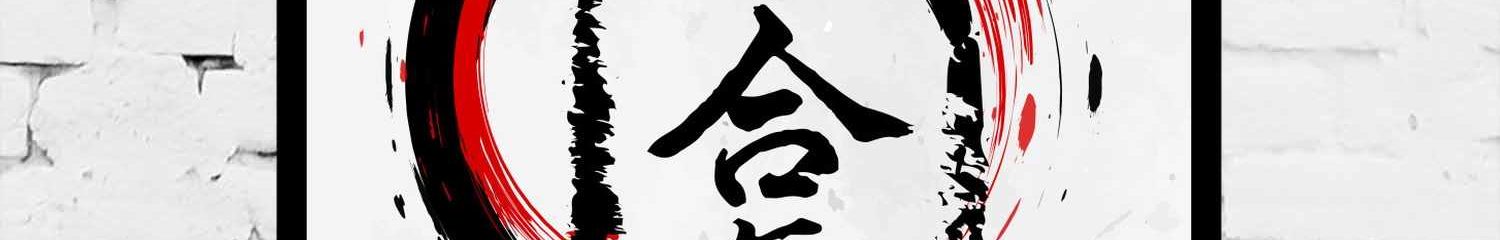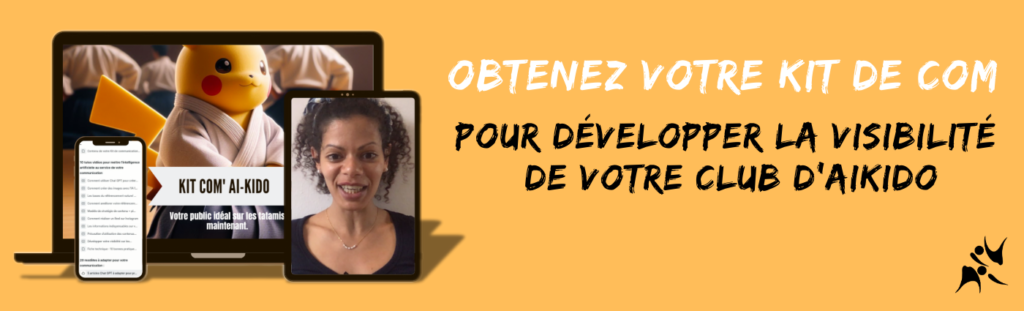Enseigner l’Aïkido ne se résume pas à transmettre un répertoire technique.
C’est un espace beaucoup plus subtil : un lieu où l’on guide sans imposer, où l’on partage sans dominer et où l’on incarne avant de corriger.
L’enseignement est une responsabilité, mais aussi un chemin intérieur.
On n’enseigne jamais seulement ce qu’on sait : on enseigne ce qu’on assume, ce qu’on choisit d’incarner et ce qu’on comprend intimement de sa propre pratique.
Et c’est précisément là que se jouent les enjeux réels :
👉 comment trouver sa place lorsqu’on débute ?
👉 que choisit-on d’intégrer et de transmettre ?
👉 pourquoi faire de la pédagogie différentiée est une responsabilité de l’enseignant ?
👉 quel rôle joue le feed-back des élèves ?
👉 comment progresser tout en suivant son propre chemin ?
Cet article réunit quatre réflexions complémentaires sur la posture d’enseignement en Aïkido, toutes issues de l’expérience vécue sur le tatami et profondément ancrées dans la réalité pédagogique.
Diriger n’est pas corriger : comment animer un cours avec des élèves plus gradés que soi

Quand on débute dans l’enseignement, une inquiétude revient souvent :
👉 et si des pratiquants plus gradés que moi sont sur le tatami ?
On peut vite se sentir illégitime, car on imagine qu’animer un cours signifie forcément corriger.
Mais en réalité, ce n’est pas le cas.
Animer, ce n’est pas juger ni reprendre les autres, mais donner une direction et installer un cadre.
C’est proposer un rythme, amener une intention dans la pratique et permettre à chacun de trouver de quoi progresser, même les élèves plus avancés techniquement.
Votre rôle n’est donc pas de montrer que vous savez plus que les autres, mais de créer les conditions pour que tout le monde puisse travailler ensemble et avancer.
Plus vous assumez cette posture, plus votre légitimité se renforce.
👉 Diriger n’est pas corriger, et c’est en assumant ce rôle d’animateur que vous prenez la vôtre sans empiéter sur celle des autres.
Et cette posture ouvre un nouveau chapitre : celui de nos choix pédagogiques, de ce que l’on intègre et de ce que l’on laisse passer dans notre propre pratique.
Pédagogie et progression : ce qu’on choisit d’intégrer aujourd’hui façonne l’enseignant qu’on deviendra demain

Je suis dans une période où je me questionne beaucoup sur ma pratique et sur ma manière de progresser en Aïkido.
Ça fait huit ans que je pratique et j’ai observé un schéma constant : chaque fois que je progresse, je passe d’abord par une phase de doute, de réajustement et parfois même de régression apparente.
Avec le temps, je réalise que ni ma progression ni ma manière d’assimiler ne sont linéaires.
Mon cerveau fonctionne en arborescence : j’ai besoin de voir une technique, de passer à autre chose et d’y revenir plus tard.
Ce sont les allers-retours, les contrastes et les reprises différées qui installent vraiment les choses dans mon corps et dans ma pratique.
Et plus j’observe mon parcours, plus je vois un autre élément essentiel : le plaisir.
Je progresse mieux lorsque je prends du plaisir à pratiquer, lorsque je suis détendue et lorsque mon corps est disponible.
Aujourd’hui, je dois composer avec mon mode d’apprentissage personnel dans un cadre où la pédagogie est construite autrement.
L’enjeu pour moi n’est pas de rejeter ce qu’on m’enseigne, mais de prendre ce que je peux intégrer réellement et d’identifier ce qui ne s’intègre pas, ou pas maintenant.
Et à force d’avoir suivi plusieurs enseignements, j’ai réalisé que certaines formes s’étaient inscrites profondément dans mon Aïkido.
Par exemple, j’ai découvert qu’il existait plusieurs façons de se déplacer en shikkō et que la version que j’avais apprise n’est pas celle qui est pratiquée dans mon club à La Réunion 🇷🇪.
Les formes que j’ai l’habitude d’utiliser sont plus circulaires alors qu’ici, elles sont plus frontales.
Il n’y a aucun jugement là-dedans : ce sont simplement des approches différentes et certaines nous correspondent plus que d’autres.
Et cette réflexion soulève une question plus large : qu’est-ce qu’on choisit vraiment d’intégrer, et qu’est-ce qu’on choisit — consciemment ou non — de transmettre ?
Je crois qu’on devient enseignant à partir du moment où l’on arrête de tout prendre et qu’on commence à choisir ce qu’on incarne.
Savoir quoi garder, quoi questionner et quoi laisser passer : c’est ça, au fond, la vraie progression technique et pédagogique.
En Aïkido, on apprend beaucoup mais on incarne peu, et c’est ce décalage qui mérite réflexion.
Et pour incarner réellement, encore faut-il accepter de se laisser regarder, d’écouter son public et de recevoir un retour honnête : c’est là que le feed-back entre en jeu.
La pédagogie différentiée, plus qu’un outil pédagogique : un véritable enjeu de cohésion au sein du cours

En Aïkido, il existe des cours où l’écart de niveau est tellement important qu’il devient impossible de transmettre exactement la même chose à l’ensemble du groupe.
Les débutants ont besoin de structure, d’un cadre clair pour construire des bases solides.
Les gradés cherchent souvent une forme de fluidité et un espace pour s’exprimer davantage dans la pratique.
Ces attentes sont légitimes, mais elles ne se nourrissent pas du même contenu technique et pédagogique.
C’est là que la pédagogie différenciée intervient.
1 — Scinder le cours : une option pertinente quand les niveaux sont trop hétérogènes
Lorsque l’écart entre les pratiquants devient trop important, scinder le cours peut être une option pertinente.
L’objectif n’est pas de créer deux mondes séparés, mais de permettre à chacun de travailler dans un espace où il peut réellement progresser.
Un groupe consolide les bases, l’autre explore des formes plus avancées.
Deux dynamiques différentes, mais un même cap.
2 — Adapter les techniques ou les attaques : une alternative tout aussi cohérente
Scinder n’est pas la seule solution.
On peut aussi choisir d’adapter les techniques ou la nature des attaques proposées selon les publics présents.
Par exemple :
– katate dori pour un débutant
– tsuki pour un gradé
Deux niveaux d’exigence, mais une concordance des saisies qui permet de maintenir la cohérence du thème du cours.
On travaille le même principe, avec un engagement différent, et chacun trouve une manière d’avancer à partir de là où il en est.
La pédagogie différenciée : une responsabilité, et un outil pour tirer le groupe vers le haut
La pédagogie différenciée est une responsabilité en tant qu’enseignant.
Elle demande de regarder le groupe que l’on a réellement devant soi, d’accepter les différences de niveaux, et d’adapter sa manière d’enseigner en conséquence.
Différencier, ce n’est pas un échec.
Au contraire : c’est la capacité d’enseigner en souplesse, d’être à l’écoute de son public d’élèves, et de tirer progressivement le niveau global du cours vers le haut.
C’est ce qui permet de préserver la cohésion, sans brider les pratiquants les plus avancés et sans laisser les débutants décrocher.
Enseignement : pourquoi demander des feed-back à ses élèves

J’écris régulièrement sur l’enseignement et la pédagogie en Aikido dans une démarche d’amélioration continue.
Mais il y a un sujet que j’aborde peu : celui de la demande de feed-back à ses élèves.
C’est un exercice difficile, car il expose la vulnérabilité de l’enseignant et implique de recevoir un retour sur des qualités humaines autant que techniques.
Une partie des élèves n’osera pas s’exprimer par peur de se sentir illégitime et d’autres comprendront que la démarche est constructive pour l’enseignant et bénéfique pour la vie du club.
👉 Sur quoi peut porter le feed-back ?
– sur la dimension technique : échauffement, choix des techniques, besoins spécifiques et objectifs individuels
– sur la prestation d’animation : élocution, énergie et pédagogie
– sur la sécurité : gestion des chutes, protection des articulations et appréhensions des élèves
– sur l’intégrité psychologique : écoute, régulation et qualité du lien sur le tatami et en dehors
Un feed-back peut donc porter sur l’ensemble des aspects de la pratique et permettre de sortir d’une logique strictement descendante.
👉 Quand faut-il s’interroger sur son enseignement ?
– quand les élèves paraissent fatigués
– quand les cours se vident
– quand les blessures augmentent
Certains enseignants notent le nombre de participants pour observer des tendances et appeler un élève absent permet parfois de comprendre une distance et de rétablir un lien.
Le feed-back n’est ni une formalité ni un questionnaire impersonnel.
C’est une remise en question régulière de son enseignement, de sa pratique et de la vie du club.
Et même s’il peut faire mal à l’ego, il reste un moyen essentiel de préserver l’harmonie du dojo — et sans harmonie, impossible d’incarner les valeurs de l’Aïkido.
Et si la progression demande autant d’ajustements, c’est aussi parce qu’elle ne peut pas être vécue sous la contrainte : elle a besoin de sens.
Ce n’est pas la contrainte qui fait progresser, mais le sens qu’on lui donne

Je me pose souvent cette question en Aïkido : peut-on réellement progresser dans le plaisir ou faut-il forcément passer par la contrainte ?
Je ne parle pas de la contrainte choisie — celle qu’on accepte pour progresser — mais de la contrainte subie : celle d’un type de pratique qu’on n’aime pas et qu’on poursuit uniquement par devoir.
Là où cette réflexion me traverse particulièrement, c’est avec le bokken.
Je n’ai jamais réussi à prendre du plaisir dans la pratique des armes, et ce malgré tous leurs bienfaits objectifs.
Et ce n’est qu’un exemple.
Je pourrais dire la même chose des éducatifs qui m’ennuient ou de la pratique statique centrée sur la respiration et du travail répétitif qui ne correspond pas à mon mode d’apprentissage.
J’ai besoin de stimulation régulière pour rester concentrée et pour sentir que j’avance.
S’ennuyer ne veut pas dire exceller : on peut s’ennuyer et être très loin d’être excellente.
Et cette réflexion n’est pas toujours simple à porter à voix haute, car elle expose aux critiques et aux jugements rapides.
Pourtant, on devrait tous pouvoir dire ce qu’on n’aime pas, même lorsqu’une pratique a des bienfaits objectifs.
C’est comme la natation : je sais que c’est excellent pour le corps, et je préfère pourtant courir, car c’est ce qui me permet de pratiquer régulièrement sans me dégoûter.
Ce sont donc de vraies questions que je pose à voix haute, sans certitude :
👉 comment chacun trouve son équilibre entre plaisir, contrainte et progression ?
Et j’aimerais ouvrir cette réflexion avec tous ceux qui ressentent ce décalage entre exigence et plaisir.
Conclusion
Enseigner l’Aïkido ne consiste pas à reproduire un technicien ni à imposer une forme unique de pratique.
C’est un chemin d’appropriation personnelle, de doutes, de choix et d’incarnation.
Enseigner, c’est accepter :
👉 qu’on ne sait pas tout ;
👉 qu’on transmet toujours quelque chose de soi ;
👉 qu’on progresse autant dans l’écoute que dans la démonstration ;
👉 qu’on doit parfois s’ajuster, renoncer, réinventer et demander un feed-back honnête.
Et c’est justement cette posture — humble, vivante et profondément incarnée — qui éloigne l’enseignement de toute autorité descendante pour le ramener à ce qu’il devrait toujours être : un espace de progression partagée.