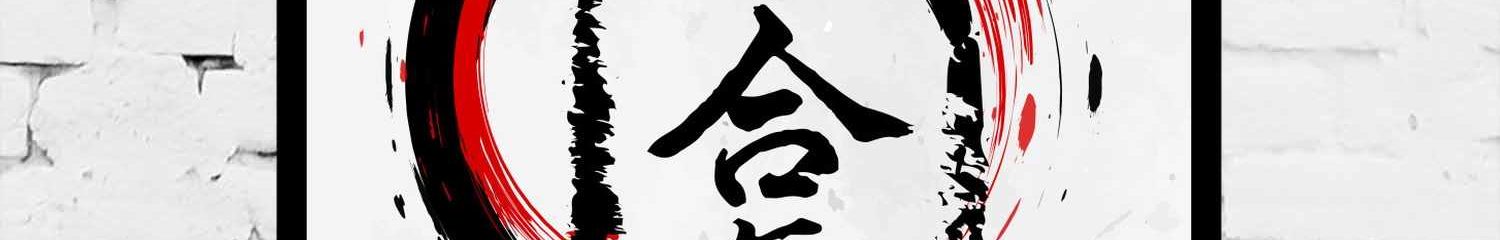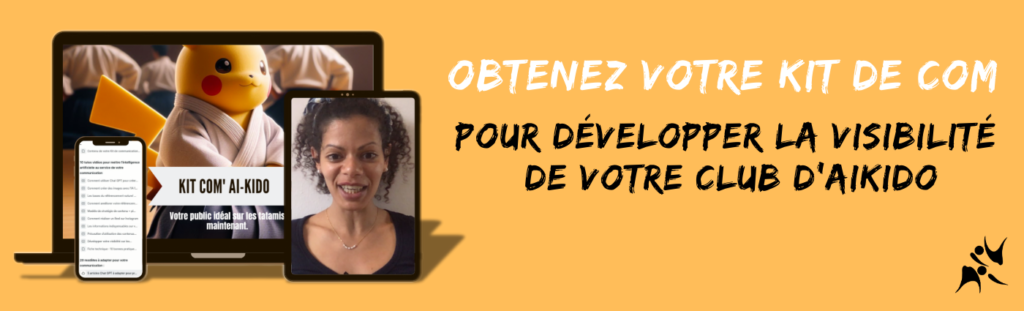La semaine dernière, je me suis rendue au stage de Léo Tamaki, à l’occasion de son séjour à La Réunion. Mon objectif était de prendre du recul sur ma pratique de l’aïkido, en me confrontant à une autre approche et en sortant de ma zone de confort. J’en repars avec cinq enseignements qui m’ont particulièrement marquée. Merci à Léo pour ces échanges constructifs et sa contribution à cet article !
1/ Placer une intention martiale et non pédagogique dans le travail aux armes

Léo consacre environ 40 % de sa pratique au travail aux armes. Mais son approche n’a rien de didactique au sens scolaire du terme : il conserve avant tout une intention martiale. Comme il le dit : « Je vise une logique martiale, pas une logique didactique. »
Il insiste d’ailleurs sur la cohérence de la démarche : « Jamais dans l’idée de pouvoir faire face à une situation. J’invite toujours ceux qui souhaitent apprendre à se défendre à s’orienter vers une discipline dont c’est l’objectif, comme le Krav Maga. » L’aïkido, dans son approche, ne se résume pas à une self-défense, mais à une recherche martiale et technique plus large.
Concernant les armes, il précise : « Le poids de mes armes est égal ou supérieur à la moyenne. Les pratiquants en avaient de plus légères, parce que le bois du Vietnam est moins dense. Cela demande simplement plus de finesse pour obtenir un effet en utilisant l’inertie »
En d’autres termes, le maniement correct d’une arme ne repose pas sur sa lourdeur ou sa légèreté, mais sur la capacité à travailler avec fluidité. Comme il le formule : « Aux armes comme à mains nues, on vise à bouger avec légèreté comme un skieur ou un surfeur, pas à être puissant comme un lutteur de sumo. »
➡️ Pour ma part, je ressens quand même une vraie différence : avec une arme plus légère, je relâche mieux mes épaules et je me sens plus vive. Peut-être que cette différence s’estompera avec l’expérience, ou peut-être que mon gabarit fera que je continuerai à la sentir, même pour 120 g d’écart !
2/ Chuter sans impact : les ukemis sans bruit

Le deuxième point marquant concerne les chutes (ukemi). Léo a rappelé qu’à l’époque de Tamura, les pratiquants chutaient sans bruit : frapper le sol n’était pas la norme.
Il reconnaît que taper peut avoir un rôle de sécurité : « Frapper permet de dissiper une partie de l’énergie quand le mouvement est arrêté. C’est comme une ceinture de sécurité. » Mais il précise aussitôt que ce n’est qu’un palliatif : « C’est mieux que rien, mais le mieux est d’apprendre à diffuser le choc en restant en mouvement. »
Concrètement, frapper le sol arrête net le corps et concentre l’impact dans la main, le bras ou l’épaule. Diffuser le choc par le mouvement (rouler, glisser, prolonger la chute) permet au contraire de répartir l’énergie et d’éviter le traumatisme brutal.
Léo fait le parallèle avec une discipline moderne : « Les pratiquants de Parkour, ne frappent jamais le sol. Ils diffusent l’énergie de saut de grande hauteur en roulant sur le béton, sans jamais se blesser. »
Il ajoute aussi un regard critique sur l’évolution de la pratique : « Si l’on est venus à introduire cette habitude de frapper, c’est sans doute lié à la recherche de spectaculaire, à l’augmentation de l’amplitude des projections, à l’ouverture du corps dans la chute. » Une dérive qui, selon lui, a fait perdre en sobriété et en sécurité.
Léo évoque des étudies scientifiques ayant démontrées que les chutes plaquées augmentent de 65% les chocs reçus. c’est énorme, compte tenu du nombre de chutes dans la pratique.”
➡️ Pour ma part, je pense en effet que frapper sur un sol dur est douloureux, et que si l’on ne mesure pas l’impact des chutes amorties par notre main, c’est parce nos conditions d’entrainement (sur tatami confortable) ne le permettent pas. Quant aux chutes claquées, j’en ai vu très peu au Japon, ou les tatamis pouvaient être bien plus durs que les nôtres, et elles sont impossibles à réaliser sur sol dur dans la durée sans conséquence désastreuses sur notre corps.
3/ Choisir le timing plutôt que l’ancrage

On entend souvent qu’il faut “s’ancrer” : descendre bas sur ses appuis, travailler à partir du centre (le hara), trouver une stabilité dans le centrage. Mais pour Léo, « concernant l’ancrage, c’est pour moi un non définitif. »
Il nuance : « Si cela peut servir dans certaines phases de combat à mains nues, cf. Sumo, etc., cela est dangereux et nous expose dès que l’on fait face à une arme. Ainsi tu ne verras jamais un escrimeur ou un kendoka ancré. »
Dans son enseignement, l’ancrage est remplacé par la mobilité et le timing. « Nous travaillons sur la légèreté comme un skieur, un surfeur, mais aussi un boxeur, un escrimeur, etc. Mohamed Ali n’invitait pas à être stable comme une montagne, mais à flotter comme un papillon (et piquer comme une abeille). »
Ce qui compte, ce n’est pas de s’ancrer profondément, mais d’être disponible et capable de bouger au bon moment. D’où une apparente contradiction avec la lenteur, qu’il a lui-même levée : « La marque de l’expertise n’est pas de bouger vite, mais plus lentement que l’attaquant. En revanche, si je demande de ne pas bouger vite, j’invite toujours à bouger tôt. »
Autrement dit, on peut travailler lentement pour garder le relâchement et la précision, mais ce qui fait la différence, c’est le timing qui l’emportera sur le facteur vitesse, qui lui n’est pas éternel selon notre condition physique. Par ailleurs, plus le geste est “sophistiqué”, à savoir épuré, dans la technique, plus on minisera les déplacements du coprs et des armes
4/ Favoriser la concentration en montrant brièvement la technique

Un autre aspect fort de son enseignement est la pédagogie. Léo explique : « Je montre la technique une fois, parfois deux, quelque fois trois. Très rarement plus. »
C’est un choix assumé, fait il y a longtemps : « Cela amène les pratiquants à être dans l’instant. À apprendre à voir. » et favorise la concentration à l’ère du trouble de l’attention.
Dans un monde où nous avons pris l’habitude d’avoir toujours une “deuxième chance” — jeux vidéo avec plusieurs vies, vidéos qu’on peut revoir à l’infini, contenus consommables à volonté — cette rareté volontaire bouscule.
« Il est bon d’apprendre à avoir une attention constante, à regarder au-delà de voir, et à apprendre à être attentif à son environnement et toujours prêt. »
Cette contrainte oblige à développer la concentration, la mémoire immédiate et l’autonomie technique — des compétences précieuses, sur les tatamis comme dans la vie quotidienne saturée de distractions.
5/ L’ouverture dans la pratique

Enfin, ce qui ressort du stage, c’est l’ouverture. Comme le dit Léo : « Nos stages sont toujours ouverts à tous les groupes, niveaux et disciplines. »
Lui-même souligne que c’est une fierté : « Ces participants sont pour moi une source de fierté. Ils m’indiquent que j’atteins les objectifs que je me fixe. Ils sont aussi dans la tradition, puisqu’à l’époque de Ueshiba, nombreux étaient les pratiquants et experts d’autres disciplines qui lui rendaient visite. »
Cette ouverture est aussi pédagogique : « L’enseignement est basé sur des principes transversaux qui nous permettent de passer d’une attaque à une autre, d’une arme à une autre, d’une forme de travail à une autre. Ils ont ainsi des éléments qu’ils peuvent immédiatement adopter s’ils le souhaitent. »
Elle se manifeste enfin dans les tenues : « Je ne fais que revenir à la tradition d’avant-guerre (jusqu’au milieu des années 60), où les couleurs n’avaient aucune importance. L’idée n’étant pas d’uniformiser, même s’il reste une formalisation avec l’adoption d’une tenue classique pour les membres de l’école. »
Conclusion
Ces enseignements ne sont pas venus flatter mes certitudes. Ils m’ont obligée à questionner ma pratique, à regarder autrement des gestes que je fais depuis des années, à accepter d’être déstabilisée.
Ce qui m’a particulièrement marquée, au-delà du stage, c’est le temps que Léo a pris pour prolonger la réflexion après coup. Ses réponses détaillées, précises et exigeantes m’ont permis de mieux comprendre la logique derrière certains choix.
Je repars avec la conviction que l’aïkido n’est pas un cadre figé, mais une discipline vivante, en mouvement, qui gagne à être réinterrogée et nourrie. Et je suis reconnaissante pour cette exigence et cette disponibilité, qui donnent envie de continuer à chercher, à pratiquer, et à garder l’esprit ouvert.