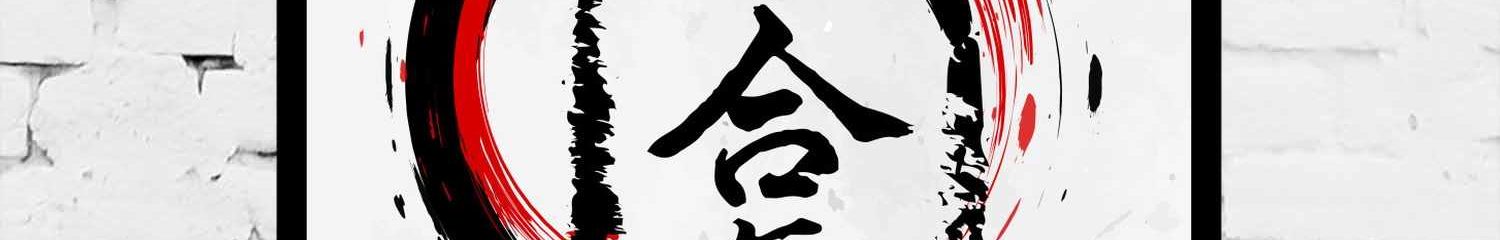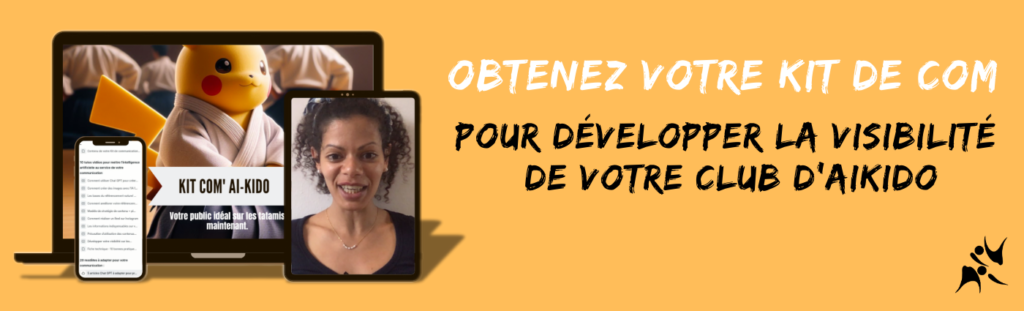Il y a dans les arts martiaux, et particulièrement en Aïkido, une forme d’ambiguïté autour de la notion d’autorité.
On parle de respect, de tradition et de transmission.
Mais parfois, on ne sait plus très bien où s’arrête le cadre… et où commence l’obéissance silencieuse.
Entre celui qui donne la permission de boire, celui que l’on appelle « maître », ou encore celui que l’on suit sans jamais le questionner, je crois qu’il est urgent de se demander : à quoi sert réellement l’autorité dans notre discipline ?
Et surtout, à quoi ressemble une autorité saine — en 2025 ?
.
Rapport à l’autorité : demander la permission pour boire de l’eau

Récemment, j’ai eu une conversation avec une pratiquante qui a fait ressortir un sujet qui revient régulièrement : demander l’autorisation d’aller boire de l’eau.
Le sujet peut sembler anodin, mais il revient souvent — et souligne la dissonance entre certaines habitudes traditionnelles et le bon sens.
À La Réunion 🇷🇪, par exemple, il est admis qu’il n’y a pas besoin de demander la permission pour aller boire.
Certes, les conditions climatiques font de cette problématique un « non sujet » mais la température ne devrait pas être la seule raison qui autoriserait un pratiquant à s’hydrater spontanément.
Personnellement, le sujet me fait bondir, car je trouve que c’est une véritable aberration de devoir demander la permission pour s’hydrater.
C’est tout simplement incohérent et surtout infantilisant.
Et pour ceux qui affirment que la tradition vient du Japon, je tiens à préciser que j’ai pratiqué dans 8 dojos au Japon 🇯🇵, dont au moins la moitié proposaient des pauses pour boire dans le cadre d’une heure de cours (j’ai même assisté à 3/4 pauses dans certains cas !).
Aujourd’hui, des élèves se font encore réprimander parce qu’ils n’ont pas demandé l’autorisation d’aller boire.
Alors remettons l’église au milieu du village : il s’agit de prendre quelques secondes pour s’hydrater dans un contexte sportif, pas de faire une pause apéro.
À force de suivre des traditions sans les questionner, on finit parfois par desservir la discipline — voire décourager ceux qui aimeraient simplement pratiquer.
.
La relation maître-élève en Aikido : un lien à revisiter

Cette anecdote en dit long sur un phénomène plus large : la manière dont on conçoit la place de l’élève face à l’enseignant.
La relation maître-élève est souvent évoquée en Aïkido.
Elle n’est pas propre à cette discipline, mais elle y est encore très présente.
À première vue, cette relation renvoie à un contexte traditionnel dans lequel un élève apprend d’un enseignant qu’il qualifie de « maître ».
Personnellement, cette relation m’évoque une autre culture et/ou une autre époque.
Dans de précédents articles dans lesquels j’ai ouvert une réflexion sur le sujet, « qu’est-ce qu’un bon professeur d’Aïkido ? », j’ai identifié un point de vigilance : la gourouisation des enseignants, dont le rôle et l’influence dépasse la simple transmission pédagogique.
Outre le risque de dérives sectaires, la problématique est plus complexe qu’elle n’en a l’air.
La relation maître-élève ne représente pas systématiquement un enseignant qui se place en “sachant” et qui aurait l’ascendant sur ses élèves.
Il existe en effet une double dynamique, où l’élève peut adopter une forme de soumission volontaire.
Alors est-ce problématique si tout le monde est consentant ?
Pour moi, oui.
D’une part, un élève qui ne remet jamais en question le savoir qu’on lui inculque ne développe pas sa capacité de réflexion.
C’est pourquoi il est important de pouvoir poser des questions lorsqu’on doute sur un tatami.
Il est en effet normal qu’un élève questionne l’efficacité d’une technique, ou qu’il s’interroge lorsqu’il ne comprend pas le sens martial derrière.
D’autre part, c’est pour moi une absence d’humilité de se placer en “sachant” lorsqu’on est enseignant.
S’attribuer ce rôle réduit la pédagogie à une transmission verticale et insinue que le maître n’a rien à apprendre de ses élèves.
C’est dommage quand on sait qu’il est possible d’apprendre au sein même de son propre dojo, avec des pratiquants moins gradés.
Apprendre de ses élèves, ça peut être :
👉 Se mettre en difficulté en faisant passer tout le monde au milieu, quel que soit l’âge, le niveau ou le gabarit.
👉 Accepter de reconnaître d’avoir “raté” une technique et de l’assumer, sans pour autant se venger sur son élève qui “n’avait qu’à mieux se placer.”
👉 Jouer le rôle de Uke ou encore chuter pour ses élèves.
Montrer son humanité en ratant ou en admettant son ignorance n’est pas un signe de faiblesse ou d’incompétence.
C’est au contraire, un signe d’humilité et d’intelligence.
Et on le voit régulièrement sur les tatamis : les enseignants qui se retrouvent en difficulté face à leurs élèves progressent, apprennent, et continuent d’évoluer. C’est encore ça, l’humilité.
Une vision dans laquelle on considère que l’enseignant et l’élève sont sur un même rapport d’égalité peut nourrir une relation riche sur le plan humain et développer un lien social fort et une vie de club développée.
Et ce dernier point n’est pas négligeable.
Rappelons que l’Aïkido en France est une activité sportive et sociale qui peut favoriser des liens forts.
Personnellement, je n’ai jamais considéré que j’avais un « Sensei ».
J’ai appris de plusieurs enseignants, mais je les ai toujours considérés comme mes égaux sur le plan humain.
C’est ce qui me permet de développer aujourd’hui une réflexion indépendante avec Aikido Millennials, qui peut certes faire l’objet de débats, mais c’est justement l’échange qui rend notre discipline vivante.
.
Mais alors, c’est quoi un “maître” en Aikido ?

Cela m’amène à une autre question que je me suis posée récemment : qu’est-ce qu’un maître ?
Même si je ne suis pas une partisane du terme, la question reste pour moi, pertinente.
👉 Est-ce un simple enseignant ?
👉 Un haut gradé ?
👉 Une personne dont nous admirons le parcours ?
👉 Une personne qui nous a formé et dont nous nous sentons redevable ?
👉 Une personne dont la pratique nous inspire ?
👉 Quelqu’un pour qui on se dévoue ? Et pourquoi ?
👉 Un enseignant d’un certain âge ?
👉 Une personne qui assure une certaine maîtrise de soi ?
👉 Celui qui montre la voie ?
👉 Un gourou ?
👉 Ou est-ce tout simplement une question d’époque ?
Par ailleurs, on peut également s’interroger sur la relation entre le dit maître et son élève : qui choisit ce titre ? L’enseignant ou l’élève ?
Je n’ai pas la réponse à cette question, mais je trouve intéressant de s’interroger sur ce qu’on met derrière ce terme qui relève parfois presque du sacré.
Le terme “maître” recouvre en effet des réalités diverses mais symbolise une certaine représentation associée au respect et à la transmission.
Mais derrière ce terme repose une question fondamentale de dynamique relationnelle.
Car derrière cette figure du maître, se joue souvent quelque chose de plus intime :
Notre rapport à l’autorité et à la reconnaissance…à savoir, ce que l’on est prêt à donner, ou à abandonner, pour être “validé”.
Et ce que l’on projette sur l’autre, et qui parfois nous empêche de voir qu’il n’est qu’humain.
➡️ Alors qu’est-ce qu’un maître en Aïkido ?
Je n’ai pas de réponse définitive à cette question.
Mais je crois qu’elle en dit long sur notre façon de pratiquer, d’apprendre…et sur la façon dont cette relation façonne notre manière d’être en tant qu’élève mais également en tant qu’enseignant.
.
.
Pour conclure
Le rapport à l’autorité mérite d’être questionné. Non pas pour défier les traditions ou manquer de respect à ceux qui transmettent l’Aikido. Mais plutôt pour l’adapter dans un contexte moderne et surtout assainir les concepts d’autorité et de respect. Car sous couvert de tradition, des comportements insidieux conduisent à des dérives : des micro-décisions, des postures implicites, des manières de faire qu’on répète sans y penser. Et qui, à force, façonnent une culture dans laquelle on n’ose plus poser de questions, ni remettre les choses à plat.
Bien sûr, tout n’est pas à jeter dans la tradition (et heureusement ! )
Mais je pense qu’il est sain — et même nécessaire — de se demander, régulièrement, si ce que l’on fait a encore du sens et si c’est en phase avec la pratique que l’on souhaite construire et les valeurs que l’on porte.
Et surtout, si ce que l’on perpétue, on le fait par conviction… ou simplement par habitude. Parce que c’est peut-être ça, aussi, transmettre un art vivant.