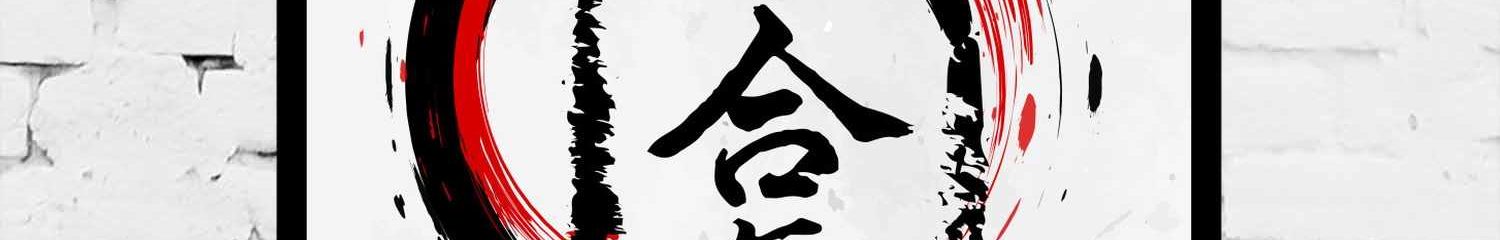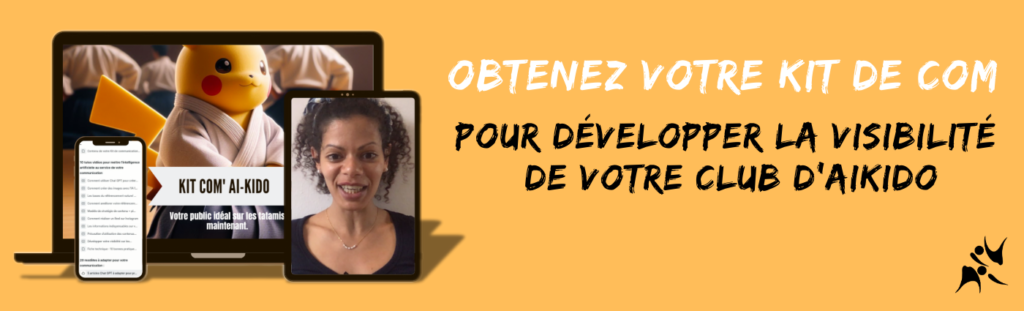L’Aïkido se définit comme une discipline martiale. Dès les premiers pas sur le tatami, le pratiquant apprend une étiquette, une rigueur et une attitude issues de la tradition des arts martiaux japonais. Le shisei — cette posture qui traduit l’engagement intérieur autant que la forme extérieure — est au cœur de cette approche.
Pourtant, cette martialité ne peut pas être comprise comme une recherche d’efficacité pure : l’Aïkido est aussi une voie où l’on collabore avec son partenaire, où l’on apprend à l’attendre, à l’écouter et à préserver son intégrité.
De là naît un paradoxe fondateur : comment un art martial, censé cultiver l’efficacité, peut-il en même temps reposer sur l’harmonie et la coopération ? Loin d’être une faiblesse, cette tension nourrit notre pratique et nous confronte à des dilemmes constants, que ce soit comme Tori, comme Uke, dans le travail du kata ou dans l’expérience de la chute.
Le dilemme de Tori : un rôle rempli de paradoxes
On parle régulièrement du rôle de Uke dans la pratique. Mais le rôle de Tori n’est pas moins important. Je vous propose ainsi un retour d’expérience personnelle sur le dilemme de Tori dans ses interactions avec son partenaire.
1/ Technique : des incohérences martiales liées à la forme
En Aikido, on peut réaliser une même technique via de nombreuses formes. Dans les faits, chaque école choisit souvent une forme de prédilection, mais qui n’est pas toujours adaptée à l’ensemble des élèves qui pratiquent sur le tatami. Certaines formes sont ainsi plus faciles à réaliser pour les grands gabarits et d’autres pour les petits gabarits. Et ce n’est pas toujours facile pour Tori, de reproduire des formes qui ne sont pas adaptées et le mettre lui-même en difficulté.
Prenons un exemple : faire un irimi nage avec un grand déséquilibre est plus difficile pour un petit Tori face à un grand Uke.
De même, certaines formes demandent à Uke d’être proactif. Parfois, cela peut être justifié (si le partenaire ne bouge pas, c’est à ses risques et péril). Exemple : hanmi handachi waza, shiho nage ura sur Katate dori.
Mais parfois, un Uke qui ne bouge pas comme on le voudrait devient un risque pour Tori.
Exemple : Tachi waza, katate dori, shiho nage omote, en ramenant son partenaire sur soi (certains vont valoriser le déséquilibre de Uke dans cette forme. Moi je vois surtout un Uke en plein élan qui fonce sur Tori).
Par conséquent, en s’enfermant dans certains types de formes, Tori se met lui-même en difficulté sur le plan martial.
2/ Le problème de la diabolisation de la force
Encore une fois, la question du gabarit n’est pas négligeable dans notre pratique. Certes, nous pouvons pratiquer avec tout type de partenaire, mais cela demande des capacités d’adaptation.
Quand un enseignant de 90 kg affirme qu’il n’utilise pas de force, et que tout réside dans son travail de hanche, c’est très possible. Mais pour être honnête, lorsqu’on fait la moitié de son poids, on obtiendra pas toujours les mêmes résultats. Par ailleurs, on diabolise l’usage de la force en Aïkido, alors qu’elle est bien présente et nécessaire (à petite dose) pour réaliser un certain nombre de mouvements.
Inversement, il n’est pas toujours facile pour un gabarit costaud de savoir s’il a fait usage de sa force ou d’une certaine puissance.
Le rôle de Tori comprend également ses propres difficultés à ne pas négliger. Le choix des formes, le gabarit et l’équilibre dans l’échange avec Uke conditionnent l’harmonie dans la pratique. C’est en prenant en considération son partenaire et en s’interrogeant sur sa propre pratique que l’on progresse dans sa technique, dans sa réflexion mais on devient également un meilleur partenaire. Et dans un Dojo, on ne cherche pas forcément à pratiquer avec le meilleur technicien, mais avec un partenaire dont on considère la pratique agréable.
Et vous, êtes-vous un partenaire agréable ?
A quel moment est-on dans l’Aïkido et à quel moment en sort-on ?

Après avoir observé les difficultés rencontrées par Tori, intéressons-nous à celles de Uke. Car dans cette recherche d’équilibre, Uke joue un rôle central : il donne la matière de l’attaque, mais il doit aussi rester disponible, attentif et juste dans son engagement.
En Aïkido, le rôle de Uke est essentiel. Dans cette dynamique harmonieuse qu’offre notre pratique, le comportement de Uke détermine la nature de l’échange. Certains se demandent même si nous pratiquons encore l’Aikido lorsqu’Uke ne répond pas au script qu’il doit reproduire. C’est d’ailleurs une véritable question : à quel moment est-on dans l’Aïkido et à quel moment en sort-on ?
Ces questionnements ont ainsi pour fondement le rôle de Uke et surtout, les dilemmes que ce dernier doit résoudre pour incarner une martialité parfois équivoque.
1/ « Attaquer sans se raidir » quand derrière chaque intention, il y a une contraction
La contraction va de pair avec l’intention dans l’attaque. On ne peut pas attaquer en étant relâché. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas apprendre à relâcher son corps par la suite, mais :
– d’abord, c’est difficile et ça vient avec le temps,
– et ensuite, le relâchement ne doit pas être un pré-requis pour pratiquer.
Si Uke est raide, on travaillera avec lui quand même sans le briser.
2/ « Attaquer sans bloquer » : une vie d’ajustements
Ici aussi, c’est un dilemme difficile car il faut trouver le juste équilibre entre le fait de rester attaquant pour donner de la matière à travailler à son partenaire, et en même temps, ne pas le sanctionner avec excès dans sa technique.
Pour y arriver, il faut des années de pratique et je dirais même, une vie d’ajustement car chaque partenaire est différent et chaque partenaire a ses propres limites physiques. Il faudra s’adapter en permanence et c’est toute la difficulté et le challenge de l’Aikido. C’est pourquoi, il est important de pratiquer régulièrement avec de nouveaux partenaires pour ne pas se maintenir dans un Aikido de confort entre amis.
3/ « Pour être un bon Tori, il faut être un bon Uke »
On dit souvent que pour être un bon Tori, Il faut être un bon Uke. Tout d’abord, il faudrait préciser ce qu’on entend pas « bon » dans les deux rôles. Par ailleurs, à titre personnel, je ne suis pas sûre de cette affirmation . Ça me fait penser à cette phrase qu’on répète souvent : « pour bien écrire, il faut lire » pour laquelle je suis un contre exemple (je lis peu).
Pour revenir à l’Aikido, on voit beaucoup d’enseignants qui ne font plus Uke, mais qui arrivent encore à transmettre (même si je suis convaincue qu’il faut faire régulièrement Uke, pas pour être le meilleur technicien en tant que Tori, mais ne serait-ce que pour avoir plus d’empathie vis à vis de son partenaire, et se dépenser un peu !).
Pour moi, chaque rôle est défini et on peut exceller dans sa technique en tant que Tori sans être soi-même un Uke disponible. Et on peut être un Uke disponible sans pour autant avoir de précision technique en tant que Tori. En revanche, jouer les deux rôles, ce que l’on fait régulièrement en Aikido, nous permet de comprendre la dynamique de notre pratique.
On dit souvent qu’Uke a le rôle le plus important dans la technique. Ce qu’on peut lui reconnaître, c’est qu’il contribue à entretenir un échange harmonieux entre les deux partenaires…tout comme Tori, qui devra préserver l’intégrité physique de son Uke.
Perdu dans le kata : la frontière fragile entre martialité et efficacité

Ces dilemmes de rôles amènent à une autre question fondamentale : celle de la codification. L’Aïkido est riche en kata, en formes codifiées qui transmettent une pédagogie et une culture. Mais dans quelle mesure ces formes préservent-elles la martialité ?
Il y a quelque temps, j’ai pu échanger avec Alexandre Alouchy sur le sujet de l’efficacité en Aïkido. Cette conversation m’a permis de prendre du recul sur ma pratique. Alex suit également les entraînements du Kishinkai, ce qui nourrit sa vision et apporte une perspective différente.
À la FFAAA, l’approche met l’accent sur le travail de hanche et l’ancrage, mais beaucoup moins sur la vitesse. Aux armes, on retrouve une grande place accordée aux kata et à la codification. L’objectif est avant tout pédagogique, plutôt que porté sur l’efficacité. Le revers, c’est qu’on peut parfois avoir l’impression de se perdre dans le kata.
Sur le plan de l’efficacité, ce constat rejoint une autre question : celle des formes de corps. La pratique que l’on enseigne et que l’on transmet correspond souvent à ce qui est adapté à sa propre morphologie. Or, en termes d’efficacité, on ne peut pas reproduire des formes qui ne correspondent pas à son gabarit.
À cela s’ajoutent certains conditionnements propres à l’Aïkido qui ne vont pas toujours dans le sens d’une efficacité martiale : travailler bas, attendre son partenaire, être relâché, ne pas lever le coude, chuter « au bon moment ». C’est tout le paradoxe de notre discipline : chercher à travailler en harmonie avec l’autre, tout en préservant une part de martialité.
Même sur le plan de l’échauffement, la question se pose. Chaque corps est différent. Certains pratiquants entretiennent leur condition physique en dehors du dojo grâce au cardio ou au renforcement musculaire. D’autres, au contraire, ont besoin d’un échauffement plus long parce qu’ils n’ont pas cette préparation en dehors des keikos. Il devient alors difficile de proposer un échauffement vraiment adapté à tout le monde.
On associe souvent le mot « efficacité » à la martialité — d’ailleurs, on parle volontiers « d’efficacité martiale ». Mais si la martialité est intrinsèquement liée au shisei, à la posture et à l’attitude, l’efficacité, elle, ne l’est pas forcément.
L’exemple du personnage de Mugen dans l’anime Samurai Champloo illustre bien ce paradoxe : il ne respecte aucun code du samouraï dans sa manière de combattre, mais il est tout aussi efficace que son partenaire Jin, qui, lui, suit une étiquette et un protocole stricts.
Finalement, que ce soit dans le kata, dans la morphologie ou dans l’échauffement, l’Aïkido nous confronte toujours à cette tension : chercher un équilibre entre ce qui est efficace et ce qui est martial. Parfois, les deux se rejoignent naturellement. Mais d’autres fois, ils s’éloignent et suivent des chemins différents. C’est peut-être justement dans cette oscillation, entre convergence et divergence, que réside toute la richesse et la complexité de notre discipline.
Fuir une chute : qu’est-ce que ça veut vraiment dire ?

Enfin, impossible de parler du paradoxe de l’Aïkido sans évoquer l’ukemi, cette capacité à chuter. Car la chute est à la fois un acte de protection, un moment de rupture du lien et, parfois, une forme de collaboration.
On entend parfois dire qu’un pratiquant fuit la chute.
Mais fuir une chute, qu’est-ce que ça veut dire exactement ?
On pourrait dire qu’une chute ressemble à une fuite : on se déplace pour se protéger, on s’éloigne pour préserver son intégrité.
En chutant, on change de mode de relation avec le partenaire.
Alors pourquoi juger le pratiquant qui anticipe un peu plus tôt ?
On dit souvent que la chute doit arriver “au bon moment” pour garder la connexion.
Mais au moment où je chute, la connexion est en train de se rompre.
Je ne suis plus avec mon partenaire. Je suis en train de me sauver.
Par ailleurs, encourager les ukemi spectaculaires, qui impressionnent ou les ukemi au timing “parfait” ne garantit pas toujours la préservation de son intégrité physique.
Un ukemi réussi, ce n’est pas seulement un bel effet visuel.
C’est avant tout une chute qui protège.
Et si cela implique d’anticiper, alors ce n’est pas une fuite : c’est une réaction de protection du corps.
La vraie question n’est donc pas de trancher entre fuite, protection ou spectacle. Elle est plutôt : qu’est-ce que l’ukemi nous apprend, à chacun, sur notre manière de nous protéger, de rester en lien et de nous exprimer ?
Conclusion
L’Aïkido se présente comme un art martial inscrit dans la tradition des budō. Le shisei, l’étiquette et l’attitude rappellent sans cesse cette origine martiale. Pourtant, sa pratique révèle une tension constante entre l’exigence d’efficacité et la recherche d’harmonie. Tori doit composer avec des formes parfois inadaptées et la question de la force ; Uke, avec la difficulté de donner une attaque juste sans bloquer ; le kata, avec le risque de perdre de vue la martialité ; et l’ukemi, avec la frontière subtile entre chute protectrice et rupture du lien.
Ce paradoxe n’est pas une faiblesse : il est le cœur même de l’Aïkido. Car c’est dans ce va-et-vient permanent entre efficacité et harmonie que nous apprenons à pratiquer, à écouter et à progresser. Et peut-être que l’efficacité véritable de l’Aïkido ne réside pas seulement dans sa martialité, mais dans sa capacité à nous transformer en partenaires plus conscients, plus attentifs et plus humains.