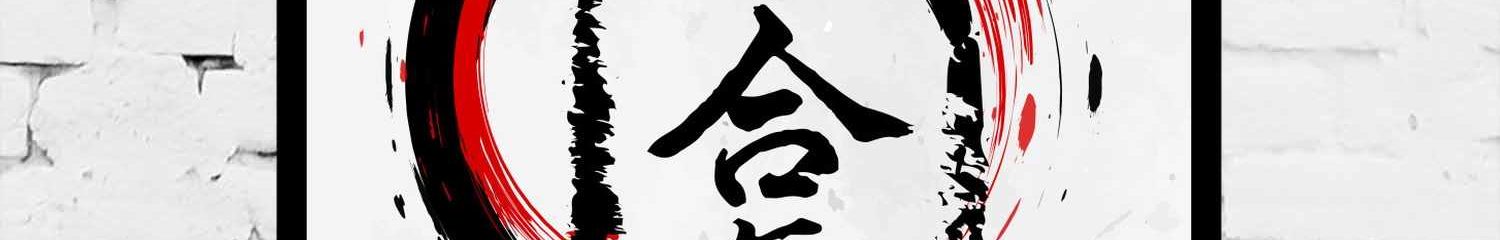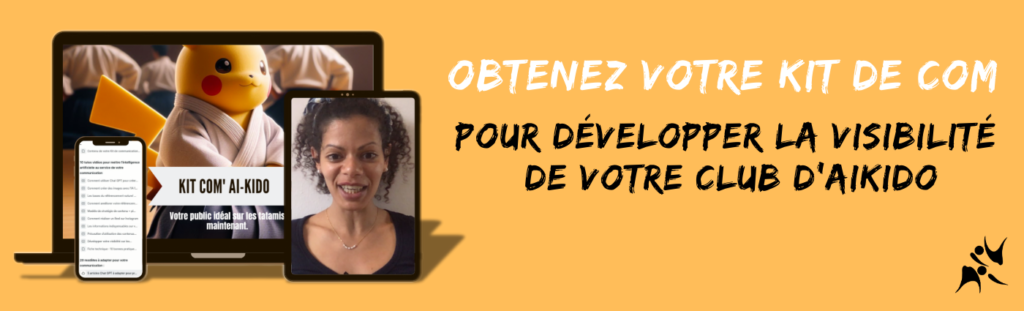En aïkido, on évoque souvent la technique, la posture ou l’efficacité du geste.
Mais il existe une dimension plus silencieuse, plus fine, qui influence profondément la manière dont on pratique à deux : la capacité à sentir ce que l’autre traverse, à percevoir ses limites, et à ajuster son propre mouvement en fonction de ce qu’on perçoit de l’échange.
Cette forme d’intelligence n’a rien d’abstrait.
Elle se manifeste dans la manière dont on accueille le corps de l’autre, dont on lit ce qu’il exprime sans les mots, et dont on veille à construire un échange qui reste sûr, respectueux et cohérent.
C’est souvent elle qui détermine la qualité de la relation entre deux partenaires, bien plus que le niveau technique.
1/ C’est quoi l’intelligence corporelle en Aïkido ?

L’intelligence corporelle s’exprime dans l’écoute, dans l’ajustement et dans la manière dont on accueille réellement ce qui se passe entre deux corps.
Elle repose sur trois repères simples.
Sentir les trajectoires et les limites physiques du partenaire
Chaque corps a son rythme, ses zones de fragilité, ses amplitudes et sa manière d’aborder le mouvement.
Pratiquer avec intelligence, c’est sentir quand une articulation arrive en fin de course, quand une rotation devient trop serrée, ou quand une chute risque d’être mal reçue.
C’est remarquer la raideur d’un bras, la fatigue qui s’installe, ou l’hésitation dans un appui — puis ajuster immédiatement.
Ces ajustements silencieux permettent à la pratique de rester fluide et sécurisée.
Lire les signaux corporels de son partenaire
Même sans parole, le corps communique en permanence : un regard qui se dérobe, une respiration qui s’accélère, une épaule qui se crispe, un rythme qui se désorganise…
Ces micro-tensions révèlent l’appréhension, la fatigue ou la surcharge mentale.
Les percevoir, c’est donner plus d’espace, adoucir une entrée ou simplifier un mouvement.
C’est être présent sans imposer son propre tempo.
Avoir conscience de ses propres limites corporelles
Lire l’autre suppose d’être capable de se lire soi-même.
On ne protège pas son partenaire si l’on ignore ses propres crispations, sa tendance à accélérer ou à forcer pour “faire passer” une technique.
Reconnaître ses limites, c’est maintenir un cadre juste et cohérent.
C’est une forme d’honnêteté envers soi qui protège autant l’autre que soi-même.
Lorsque l’on comprend cela, on réalise que la pratique ne dépend pas uniquement de ce que le corps fait, mais aussi de la manière dont il se prépare, se stabilise et se libère.
Et c’est là que d’autres dimensions entrent en jeu : la souplesse, le gainage et toutes les tensions inconscientes qui façonnent notre façon de bouger.
2/ Souplesse, gainage, tensions : comment influencent-ils la pratique de l’Aïkido ?

En travaillant récemment avec une amie sur des exercices de souplesse et de gainage, j’ai pris conscience d’un décalage. Le fitness que je pratique depuis des années n’a jamais développé ma souplesse — ce n’était pas mon objectif. Mais il a renforcé mon gainage, et aujourd’hui, c’est ce qui m’apporte le plus sur le tatami.
On entend souvent que la souplesse protège des blessures. Pourtant, c’est plus complexe.
Oui, c’est une question d’amplitude, mais l’aïkido n’entretient pas véritablement cette qualité, hormis quelques mouvements d’échauffement.
Et surtout : ce n’est pas la souplesse qui rend le corps disponible.
Ce qui libère vraiment, c’est l’absence d’appréhension.
La peur de tomber, de mal chuter ou de mal faire bloque bien plus que n’importe quelle raideur.
On peut être très mobile sur certains plans — comme mes poignets — et tendu ailleurs, notamment lorsque le renforcement musculaire crée des crispations dont on n’a pas conscience.
À l’inverse, le gainage, souvent absent des dojos, stabilise, ancre et sécurise. C’est pourquoi une préparation physique est nécessaire à la pratique.
La planche, le gainage latéral, la force du centrage : tout cela influence directement la manière dont on reçoit et dont on exécute le mouvement.
Finalement, la question n’est peut-être pas seulement : « suis-je assez souple ? », mais : est-ce que mon corps accompagne la technique ou est-ce qu’il la subit ?
Cette réflexion m’a ramenée à un autre constat : malgré mes appréhensions, malgré mes raideurs et mes tensions, je n’ai jamais vécu de blessure en huit ans d’aïkido.
Et ce n’est pas un hasard.
3/ 8 ans d’Aïkido sans blessure : mes appréhensions m’ont protégée

On dit souvent que la peur freine.
Pourtant, dans ma pratique, elle m’a protégée.
Mes appréhensions m’ont poussée à ralentir, à vérifier mes appuis, à écouter ce qui se passait réellement, chez moi et chez l’autre.
Elles m’ont obligée à sentir davantage, à anticiper ce qui pourrait devenir dangereux, à ne jamais brusquer le mouvement.
C’est cette attention — née du doute, de la prudence, parfois même de la retenue — qui m’a permis de pratiquer huit ans sans blessure.
Elle a renforcé cette intelligence corporelle que je n’aurais peut-être pas développée autrement.
.
4/ Aikido : ce qui est normal sur un tatami et ce qui ne l’est pas
.
Il y a un sujet que beaucoup de pratiquants préfèrent éviter, alors qu’il impacte directement la manière dont on vit l’Aïkido : la différence entre ce qui est normal sur un tatami, et ce qui ne devrait jamais le devenir.
En Aïkido, il est normal d’être un peu bousculé, d’avoir des appréhensions sur certaines chutes, ou de sentir que son équilibre est mis à l’épreuve.
C’est le fonctionnement même de la discipline, et cela fait partie du processus d’apprentissage.
En revanche, il n’est pas normal de pratiquer avec une tension corporelle permanente.
Ce n’est pas normal que le corps se mette en état de vigilance avec certains pratiquants, parce qu’on sait qu’ils ne s’adaptent pas.
Et ce n’est pas normal de recevoir des coups : les atemis ne sont pas censés être portés, et encore moins utilisés pour “tester” ou “durcir” un partenaire.
Dans un cours, ce n’est jamais au moins gradé d’essayer de suivre le rythme du plus gradé.
C’est au plus gradé de réguler la cadence, d’ajuster l’intensité et de garantir la sécurité de l’échange.
Lorsqu’une personne refuse de le faire, elle crée un espace où l’on n’apprend plus : on se protège, on anticipe, et on finit par s’éloigner de la pratique elle-même.
Beaucoup de pratiquants vont intérioriser la situation.
Ils se disent qu’ils ne sont pas assez rapides, pas assez solides ou pas assez “bons” pour suivre.
Ils culpabilisent de ressentir de la peur, ou pensent qu’un grade supérieur légitime tout comportement.
Et à force de rationaliser, ils minimisent complètement ce qu’ils ressentent physiquement.
Pourtant, c’est précisément ce ressenti qui devrait servir de repère.
Si je me crispe avant même de commencer à travailler,
si je n’arrive pas à me relâcher avec une personne en particulier,
si je suis à l’aise avec tout le monde sauf elle,
alors le problème ne vient pas de mon niveau, ni de mon engagement.
Le problème vient de la manière dont cette personne pratique.
Sur un tatami, il y a déjà suffisamment de défis : dépasser ses propres appréhensions physiques, développer le relâchement, affiner la précision technique, comprendre ses tensions et ajuster son corps au fil des années.
On n’a pas à dépenser son énergie à éviter des partenaires qui ne respectent pas l’échange.
Parce que s’il y a bien une chose que l’Aïkido devrait nous transmettre avec l’expérience, c’est l’intelligence corporelle : la capacité d’adaptation.
Et cette capacité d’adaptation incombe d’abord à la personne la plus expérimentée, celle qui doit ajuster son rythme, sa précision et son intention pour créer un échange juste, sécurisant et cohérent avec la pratique.
Ce n’est pas être fragile que de vouloir pratiquer en sécurité.
Au contraire, c’est être en harmonie avec les valeurs de l’Aïkido.
Conclusion
Le respect du corps rappelle quelque chose d’essentiel dans la pratique : on ne progresse pas uniquement en améliorant une forme, mais en comprenant ce qui se joue réellement entre deux personnes.
L’intelligence corporelle, la gestion des tensions, la lecture des signaux du partenaire et la conscience de ses propres limites forment un ensemble cohérent.
C’est ce cadre-là qui rend l’échange juste, sûr et lisible.
On peut chercher la précision du geste, affiner sa posture ou répéter une technique encore et encore.
Mais l’aïkido ne se résume pas à ça.
L’objectif n’est pas la perfection du mouvement : l’objectif, c’est l’harmonie avec son partenaire.
C’est là que la pratique prend tout son sens et que le fameux lien se crée.